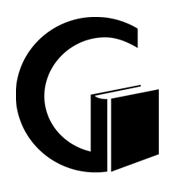Lieux de cérémonie
J’ ai adoré grandir dans un milieu où l’ on apprenait en famille. Mes parents nous ont montré comment élever des animaux, chasser, pêcher et faire du sirop d’ érable. Mes tantes et mes oncles venaient souvent à la maison. Ils nous racontaient des anecdotes de leur enfance, des récits traditionnels de nos ancêtres et autres histoires du passé.
Je me souviens que nos parents nous emmenaient camper. Lors de ces excursions, nous explorions le lac Supérieur et, plus particulièrement, le territoire de notre peuple. L’ un de nos endroits préférés était le site des pictogrammes du rocher Agawa (qui est d’ ailleurs le nom de famille de mon grand-père paternel). Là-bas, mon père nous parlait des ancêtres de notre peuple qui ont dessiné ces signes sur la paroi du rocher aux 17e et 18e siècles. J’ étais impressionnée par ces images remarquables et par le fait que notre peuple s’ en servait comme moyen de communication et repère géographique.
J’ étais loin de me douter que ces moments passés en famille alors que je n’ étais qu’ une enfant naïve marquaient en fait le début de mon apprentissage. Ils ont contribué à façonner l’ adulte que je suis, celle qui avance sur le chemin rouge en trouvant l’ équilibre entre mes traditions et ma vie de citadine contemporaine.
À l’ adolescence, je ne saisissais pas réellement l’ ampleur des conséquences que le génocide culturel et la colonisation ont eues sur ma famille et ma communauté. J’ avais 16 ans la première fois que j’ ai entendu mon père parler ojibwa. J’ étais au centre commercial avec mes parents; mon père buvait un café pendant que je magasinais avec ma mère. À notre retour, mon père discutait à voix basse avec un ami d’ enfance. Ils parlaient en ojibwa, avec une grande facilité! Ça a été un moment charnière pour moi. Je me suis demandé pourquoi mon père ne s’ était jamais adressé à ses enfants dans cette langue, puisque je savais pertinemment qu’ elle jouait un rôle essentiel dans notre culture et nos cérémonies. Plus tard, j’ ai appris que mon père baissait le ton lorsqu’ il parlait ojibwa à cause de son expérience dans le système des pensionnats indiens, où l’ on interdisait aux enfants autochtones de vivre quelque aspect que ce soit de leur culture. La perte fut immense pour les générations suivantes.
Ils ont contribué à façonner l’ adulte que je suis, celle qui avance sur le chemin rouge en trouvant l’ équilibre entre mes traditions et ma vie de citadine contemporaine.
Au début de l’ âge adulte, alors que je vivais à Toronto, j’ ai renoué avec les cérémonies de façon plus personnelle. Il y avait partout dans la ville de nombreux lieux sûrs où tenir des cérémonies. On m’ a invité à fabriquer un tambour à main anishinaabe traditionnel sur le territoire d’ une autre nation anishinaabee. Durant la cérémonie, j’ ai créé mon tambour, je lui ai donné naissance, je lui ai insufflé la vie et j’ ai fait un festin en son honneur. Il était important pour notre peuple de trouver des lieux de cérémonie où nous pourrions continuer de vivre ensemble nos traditions sans craindre des représailles de la part du gouvernement. J’ étais très loin de mon territoire natal, mais d’ autres nations anishinaabees m’ ont accueillie et laissée tisser des liens à travers les cérémonies. C’ est ainsi que j’ ai pu assister à des cérémonies du calumet, à des cérémonies de dénomination et aux enseignements des autres femmes. J’ ai même participé à des cérémonies de remise de couleurs et à des huttes de sudation. Encore aujourd’ hui, l’ odeur du bois fraîchement coupé et les flammes d’ un feu crépitant me rappellent le jour où j’ ai fabriqué mon premier tambour à main et ma première expérience dans une hutte de sudation. Ces moments sont gravés à jamais dans ma mémoire. Je suis reconnaissante et honorée d’ avoir pu profiter de ces lieux qui nous ont été offerts, à moi et à d’ autres Anishinaabeg habitant dans des centres urbains. Il est précieux de pouvoir renouer avec la terre, même quand nos corps ne sont plus physiquement ancrés dans nos territoires natals.

Il y a quinze ans, j’ ai déménagé à Kingston, en Ontario, avec mon mari et mon fils (j’ en ai maintenant deux). Après quelques mois, j’ ai senti le besoin de participer à une cérémonie et de trouver un endroit où jouer du tambour. Mais je ne me sentais à l’ aise nulle part. Il y avait sur ce territoire une vibration particulière qui me troublait. En parlant avec d’ autres personnes autochtones nouvellement établies à Kingston, j’ ai conclu que le territoire dégageait de l’ instabilité à cause des nombreuses batailles qui s’ y sont déroulées entre les peuples autochtones et non autochtones. Ce que nous ressentions, c’ était l’ énergie résiduelle de ces conflits. Il nous fallait tenir une cérémonie au bord de l’ eau pour nous présenter au territoire. En chantant et en jouant du tambour, nous avons instauré une énergie harmonieuse qui nous rendait à l’ aise de continuer à faire des cérémonies et inspirait le respect des différences culturelles de nos nations.
Peu après mon arrivée à Kingston, j’ ai rencontré une aînée, qui m’ a prise sous son aile et m’ a guidée dans mon nouveau parcours de vie, celui de la découverte de soi. Durant ce parcours, je sentais le besoin de m’ entourer de « mon peuple anishinaabe ». Je n’ avais plus accès au lieu sûr de mon territoire natal, où je pouvais prendre part à des cérémonies et en tenir. La solution était donc de procéder à une cérémonie introspective pour comprendre comment satisfaire mon besoin de communier avec le territoire où j’ étais maintenant installée. Une étape importante a été de me renseigner sur l’ histoire de ce territoire. Cela m’ a amenée à mieux connaître les premiers peuples qui s’ en sont occupés. Lorsque j’ ai découvert que l’ un d’ entre eux était les Mississaugas, des Ojibwés, j’ ai su que je devais poursuivre mes recherches. On nous enseigne que l’ acquisition du savoir passe par l’ apprentissage et l’ écoute. Une fois acquis, ce savoir doit être retransmis en toute humilité. Ce que j’ ai appris sur les pratiques de troc et les cérémonies des Mississaugas du peuple ojibwé m’ a apaisée.
J’ ai maintenant bouclé la boucle de mon parcours introspectif, et j’ ai compris l’ importance des cérémonies, qui font partie intégrante de ma personne, de mon ADN. L’ héritage de mes ancêtres coule dans toutes mes veines. Grâce à mon besoin de cérémonie, j’ ai appris que lorsque je nourris bien mon esprit, j’ en tire la force nécessaire pour me réapproprier les lieux de manière respectueuse. En reconnaissant que le territoire appartenait à d’ autres avant nous, nous entretenons un lien culturel fort, peu importe où nous habitons. C’ est aussi une pratique essentielle pour se réapproprier des lieux de cérémonie dans le respect.
Je viens d’ une lignée remarquable de personnes résilientes et solidement ancrées dans leur culture. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père était le chef Shingwaukonse, le premier de notre communauté. Mon peuple compte des Midewiwins (guérisseurs et guérisseuses), des enseignants de la langue traditionnelle, des gardiens du calumet traditionnel, des aînés, des leaders communautaires, des guerriers et des gardiens du savoir, dont je fais partie. Où que je pose le pied, je suis toujours ancrée dans cérémonies. Chi-Miigwetch à tous mes amis.

Commandez maintenant
sur Amazon.ca ou Chapters.Indigo.ca, ou communiquer avec votre libraire ou marchand éducatif préféré